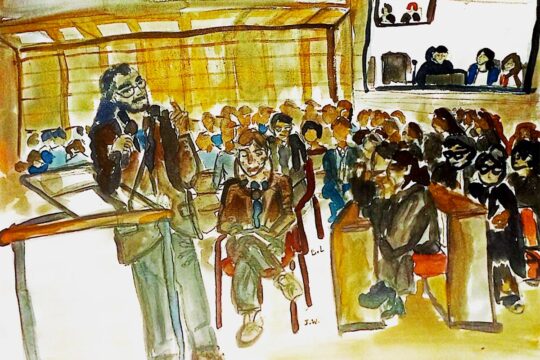Les décisions des juridictions internationales mettent de plus en plus la pression sur les Etats et les entreprises, sommés d'assumer leur responsabilités climatiques, comme l'illustre un avis consultatif très attendu mercredi de la Cour internationale de justice (CIJ).
Après des décisions importantes d'autres institutions, la plus haute juridiction mondiale doit trancher la délicate question des obligations légales des gouvernements face au changement climatique et éventuellement se prononcer sur le principe pollueur-payeur pour les dommages subis par les pays vulnérables.
- Comment les litiges climatiques ont-ils évolué ?
Selon Andrew Raine, du département juridique du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), c'est la frustration face à la lenteur de l'action climatique qui incite citoyens, organisations et pays à saisir les tribunaux.
"Lorsque les systèmes politiques échouent, le droit est de plus en plus perçu comme un outil permettant d'accroître les ambitions et de faire respecter les engagements", déclare-t-il à l'AFP.
Cette tendance s'est renforcée grâce aux données scientifiques de plus en plus précises sur le climat, notamment celles des experts du Giec.
Près de 3.000 affaires liées au climat ou à l'environnement avaient été déposées fin 2024 dans près de 60 pays, selon l'Institut Grantham sur le changement climatique à Londres.
Et certains cas ont incité les États à agir davantage.
En 2019, l'organisation environnementale néerlandaise Urgenda a obtenu que la Cour suprême néerlandaise ordonne au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% avant la fin de l'année suivante.
En 2021, la Cour constitutionnelle allemande a jugé que l'inaction climatique du gouvernement imposait un fardeau inacceptable aux générations futures.
Les litiges dépassent désormais souvent les frontières, avec 24 affaires devant des cours, tribunaux ou autres organismes internationaux.
"Cela marque un tournant et reflète le caractère transfrontalier et partagé de la crise climatique", note M. Raine.
- En quoi les affaires récentes sont-elles décisives ?
Deux affaires en particulier ont été saluées comme des moments cruciaux.
En 2024, le Tribunal international du droit de la mer a déclaré, dans un avis consultatif, que les émissions de carbone pouvaient être considérées comme un polluant marin et que les pays avaient l'obligation d'agir pour réduire leurs effets sur les océans.
Le tribunal a clairement conclu que définir les obligations des pays ne relevait pas seulement de l'Accord de Paris et de l'ONU Climat, souligne Nikki Reisch du Centre pour le droit international de l'environnement (CIEL).
Et début juillet, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a sommé les pays de l'Organisation des Etats américains (OEA) d'adopter "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les populations face au changement climatique, et a reconnu les droits de la nature.
Mais pour Cesar Rodriguez-Garavito, directeur du Climate Law Accelerator à l'Université de New York, le plus marquant est ailleurs.
"(La Cour a déclaré) que les dommages massifs et graves causés au système climatique par les émissions, la déforestation, etc., sont absolument interdits par le droit international", plaçant la protection contre les dommages climatiques irréversibles au même niveau que les interdictions du génocide et de la torture.
C'est, selon lui, la déclaration la plus ferme jamais formulée par une cour internationale sur le devoir des États d'éviter de graves destructions écologiques.
- Quel impact pour l'avis de la CIJ ?
Vanuatu, l'une des nombreuses îles menacées par l'élévation du niveau de la mer, a demandé à la CIJ de donner son avis sur les obligations des États en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais la demande potentiellement la plus controversée concerne les conséquences juridiques pour les grands pollueurs responsables de graves dommages climatiques.
"Ce sont des questions de justice mondiale" avec des impacts potentiels sur la délicate question de la "réparation des dommages climatiques", déclare M. Rodriguez-Garavito.
Bien que les avis de la CIJ ne soient pas juridiquement contraignants, M. Raine leur reconnaît un poids considérable.
"Ils clarifient la manière dont le droit international s'applique à la crise climatique, ce qui a des répercussions sur les tribunaux nationaux, les processus législatifs et les débats publics. Cela n'oblige pas les États à agir, mais cela leur montre où en est la loi et dans quelle direction ils doivent aller".