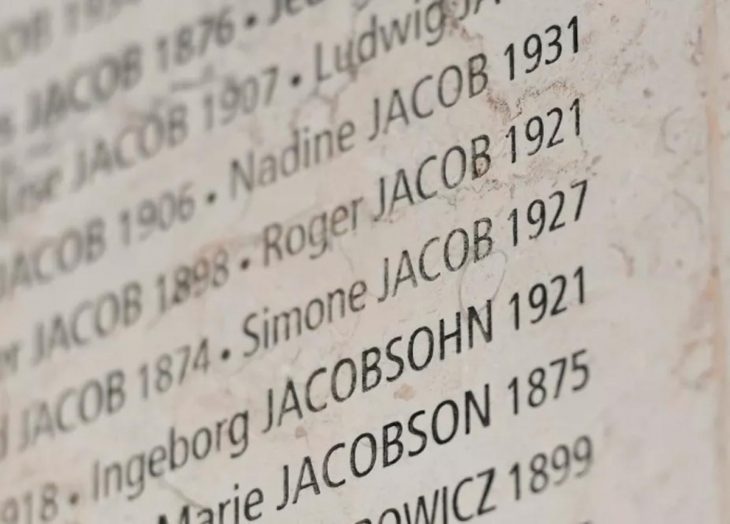« On n’enseigne plus la Shoah » dans de nombreux collèges et lycées. Telle est l’antienne souvent répétée par des éditorialistes, des pseudo-spécialistes, des essayistes pressés et de nombreux responsables politiques lorsque des actes antisémites sont commis en France. L’accusation autorise à mettre en cause les enseignants qui, pour ne pas heurter certains élèves, renonceraient à traiter de la destruction des Juifs d’Europe en cédant ainsi à des pressions inacceptables.
Au-delà des professeurs, l’institution elle-même est quelquefois visée par celles et ceux qui estiment que la situation empire d’année en année. Selon la formule employée par le chœur éploré des nostalgiques d’un passé scolaire et académique mythifié, « c’était mieux avant. » Singulière affirmation. Rappelons aux membres de cette cohorte hétéroclite qu’il a fallu attendre près de quarante ans pour que la « Solution finale » soit enfin enseignée dans les établissements secondaires de l’Hexagone.
Ajoutons, et ceci a quelque rapport avec le retard de cette trop lente évolution, que, sur ce sujet, la France s’est longtemps distinguée par un provincialisme scientifique et éditorial remarquable. À preuve parmi beaucoup d’autres possibles : l’ouvrage majeur, aujourd’hui un classique, de Raul Hilberg, La Destruction des juifs d’Europe.
Ce politiste, devenu historien, a commencé ses recherches en 1948, dans l’indifférence générale. Et il a publié cette somme exceptionnelle pour la première fois aux États-Unis en 1961 dans un contexte où, dans les universités comme dans le champ politique, ils n’étaient pas nombreux ceux qui s’intéressaient à cet événement et jugeaient indispensable de lui consacrer des livres, des articles et des enseignements. Quant à la traduction française, elle n’a été réalisée qu’en 1988.
Enfin, et c’est pour partie une conséquence de cet état de fait longtemps persistant, les femmes et les hommes nés dans les années 1960 n’ont pas appris ce qu’ils savent sur le génocide perpétré par les nazis et la collaboration du régime de Vichy dans les établissements secondaires et supérieurs mais au gré de rencontres et de lectures personnelles.
Stigmatisation et généralisation
Les accusations précitées, parfois implicites, sont tout à fait explicites sous la plume de l’historien Georges Bensoussan, par exemple, qui n’hésite pas à écrire dans Les Territoires perdus de la République : « c’est cet antisémitisme que l’immigration arabo-musulmane dans notre pays a introduit au sein de la République », qui conduit des professeurs à faire l’impasse sur cette histoire.
Les jeunes héritiers de l’immigration postcoloniale et leurs parents sont ainsi doublement stigmatisés. D’une part, à cause de leur haine supposée des Juifs qui serait liée à leurs origines ethniques comme à leur religion réputée hostile à ces derniers. D’autre part, en raison de la capacité imputée à ces élèves d’empêcher que les cours relatifs à la « Solution finale » aient lieu.
Ces accusations sont d’une extrême gravité. Les « jeunes d’origine maghrébine » deviennent, sous la plume de cet auteur, l’incarnation d’une dangerosité polymorphe, morale, sociale et politique qui ruine des principes démocratiques majeurs, met en échec l’institution scolaire et la République elle-même, dont l’autorité serait sévèrement ébranlée. Sorte de cinquième colonne, cette immigration ferait peser sur la France une menace quasi existentielle.
« Sauvageons » dénoncés hier par Jean‑Pierre Chevènement (1999), « racailles » qu’il faut traiter au Karcher, selon les propos délicats de celui qui était ministre de l’Intérieur en 2005, Nicolas Sarkozy, qui fustigeait ainsi des atteintes jugées réitérées à la sécurité des biens et des personnes, antisémites désormais ; tels sont donc ces collégiens et ces lycéens, selon Georges Bensoussan et les nombreux adeptes de cette thèse qui fait florès parmi la droite et l’extrême-droite, comme au sein d’une certaine gauche.
On est en droit d’exiger d’un historien qui prétend étudier des phénomènes complexes et contemporains qu’il produise les éléments d’enquêtes significatifs permettant d’étayer ses analyses sur des fondements solides. Il n’en est rien. Des témoignages auxquels succèdent une généralisation hâtive, des affirmations simples et péremptoires servies par des formules hyperboliques suffisent pour établir un bilan sans appel : la situation serait catastrophique.
Bilans sur le terrain
En 2006, le Mémorial de la Shoah a lancé une enquête sur le sujet qui dément une telle conclusion. Si des incidents sont parfois constatés, ils demeurent limités, comme le note Laurence de Cock dans une contribution synthétique et informée (« “On n’enseigne plus la Shoah”, retour sur les usages politiques d’une doxa » in Transmettre la criminalité de masse du nazisme. Des mémoires à inscrire dans l’histoire).
Douze ans plus tard, le rapport de la mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse – élaboré par Vincent Duclert, Anouche Kunth et Hélène Dumas, avec le concours d’une équipe internationale de 65 chercheurs et professeurs – le confirme. Fort de 1 700 pages, ce rapport, qui a nécessité deux ans de travail, a été immédiatement publié par le CNRS.
On y découvre que « le bilan de l’enseignement » consacré à la destruction des Juifs d’Europe « s’est révélé positif ». Entre autres, parce qu’il intègre de nouvelles méthodes pédagogiques, qu’il s’inscrit désormais dans une approche pluridisciplinaire et qu’il s’est enrichi grâce à l’étude d’autres génocides perpétrés au XXe siècle : celui des Hereros et des Namas dans la colonie allemande du Sud-Ouest africain (actuelle Namibie), commis en 1904 par les troupes du général Lothar von Trotha, celui des Arméniens (1915) et celui des Tutsi (1994).
Des approches transversales
Relativement aux universités, de tels enseignements, nourris par les recherches nationales et internationales menées sur les génocides, les crimes contre l’humanité et les violences coloniales extrêmes employées par de nombreux États européens, dont la France – notamment à la suite de la Conférence de Berlin (15 novembre 1884-26 février 1885) qui a favorisé « la course à l’Afrique » – doivent être développés plus qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Eu égard aux disciplines existantes, ces enseignements pourraient trouver leur place en histoire, sciences politiques, droit, philosophie, anthropologie, littérature, etc. Cela favoriserait le développement d’approches comparatives et multiples permettant aux étudiant·e·s de saisir au mieux les origines complexes de ces événements de nature diverse, leur surgissement catastrophique dans des contextes différents et les nombreux problèmes qu’ils posent toujours aux contemporains que nous sommes.
Si grâce au travail pionnier de Georges L. Mosse – De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes – nous en savons davantage sur les voies qui ont conduit au surgissement de ce dernier régime, l’œuvre de Hannah Arendt, consacrée à l’impérialisme et à l’avènement de la domination totalitaire, demeure féconde et en France trop peu explorée (cf. L’Impérialisme in Les Origines du totalitarisme).
Le 6 mars 2019, l’université d’Evry-Val-d’Essonne organise une journée d’étude intitulée « Génocide(s), vérité et justice » qui abordera les génocides à travers les yeux des témoins directs.![]()
Olivier Le Cour Grandmaison, Professeur de sciences politiques, Université d’Evry Val-d’Essonne – Université Paris-Saclay
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.