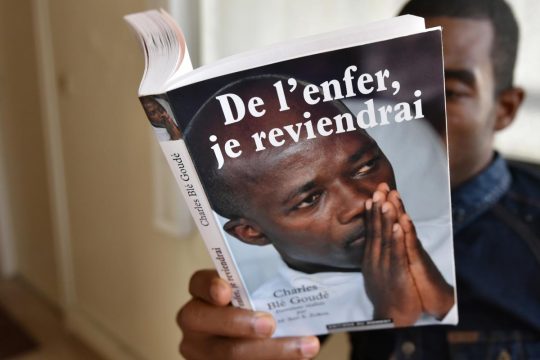La Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP) a fêté ses vingt ans jeudi 7 juillet à La Haye, où elle a récemment installé ses quartiers. Etablie en 1996 à l’initiative de l’ex président Bill Clinton suite à la guerre en ex-Yougoslavie, la Commission a pu identifier plus de 22 000 disparus en Bosnie-Herzégovine, permettant à leurs proches de faire le deuil, obtenir justice et tenter d’obtenir réparation. Depuis 2003, avec une première mission en Irak, l’organisation a lentement étendu son champ d’action pour travailler sur tous les disparus : victimes de guerres, de désastres naturels, ou de trafics d’êtres humains. En décembre 2014, la Commission passait du statut d’association à celui d’institution, par le biais d’un traité ratifié à ce jour par neuf Etats, lui permettant d’assoir une stratégie globale. Pour sa directrice générale, Kathryne Bomberger, la question des disparus reste néanmoins sous-estimée, et va bien au-delà du seul impératif humanitaire. Kathryne Bomberger répond aux questions de notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas.
Combien compte-t-on, aujourd’hui, de disparus à travers le monde ?
Il n’y a pas de statistiques globales. Il y a eu 40 000 disparus dans les conflits d’ex-Yougoslavie (1991-1995 et 1999-2000), dont 30 000 pour la seule Bosnie-Herzégovine, il y a aussi 65 000 disparus en Colombie, 60 000 en Syrie, et d’autres, au Cachemire, au Népal, en Ouganda, et ailleurs. Nous gérons actuellement 150 000 profils biologiques, du Tsunami en Thaïlande, à l’ouragan Katrina, au conflit en Bosnie, en Irak, en Afrique du Sud, au Chili, en Libye. Notre expérience en Bosnie et dans la région démontre que cela devrait être considéré comme une question internationale. Nous avons été capables d’apprendre en Bosnie, avec les citoyens, avec leurs gouvernants, que l’on peut retrouver les personnes disparues. Ce n’est pas quelque chose d’impossible. Aujourd’hui nous avons les outils, nous avons un statut. Mais il faut comprendre que le grand nombre de disparus constitue une menace pour la paix et la stabilité des Etats. Si des personnes ont souffert de disparitions forcées par des acteurs étatiques, particulièrement quand le conflit se termine et que ces individus sont encore au pouvoir, vous avez un immense écart entre les survivants et les Etats. S’il n’y a pas de prise de responsabilité, la société, ou les victimes laissées sur le bas-côté, ne seront jamais capables de reconstruire une relation de confiance avec l’Etat. Et je crois que l’on peine à reconnaître cela, même en Syrie aujourd’hui. Une fois que les individus ont de la nourriture et un abri, ils veulent savoir où sont leurs proches. Nous pensons que c’est bien plus qu’une question humanitaire. Dans presque toutes les catégories, ces affaires de personnes disparues sont liées à des crimes, à l’exception des désastres naturels, et encore. Mais pour les Etats, c’est une honte. Pour ne prendre que la Bosnie, elle n’aime pas qu’on lui rappelle que 30 000 personnes étaient disparues. C’est l’une des raisons pour lesquelles personne ne veut parler de cela. Personne ne veut parler des charniers dans son propre pays. Mais qui souffre des conséquences de cela ? Ce ne sont pas uniquement les survivants, c’est aussi le pays lui-même. Ne pas en parler, ne pas traiter cette question, c’est préjudiciable pour la construction de l’Etat, n’importe quel Etat, y compris les Etats-Unis qui ont à faire avec les migrants disparus à la frontière entre Mexico et l’Arizona. Il y a un vide dans le droit international humanitaire, dans la façon dont le monde s’est emparé de cette question, qui est, franchement, aussi vieille que l’humanité ! Et je trouve plutôt ironique qu’il ait fallu attendre 2015 pour que vous ayez une organisation qui finalement gère cette question.
Vous plaidez en faveur d’un traitement de la question des disparus dans le conflit syrien. Où en êtes-vous ?
Nous pouvons commencer maintenant - et même si maintenant c’est déjà tardif - à construire la confiance des survivants. Comme organisation, nous pouvons travailler avec eux, aller sur le terrain et collecter des informations sur leurs proches disparus. Nous pouvons dès à présent stocker ces données, qui seront disponibles lorsque le conflit sera terminé, quel que soit le futur de la Syrie. Mais nous dépendons des survivants. Pour les données aujourd’hui, nous n’avons plus besoin d’aller sur le terrain avec une feuille et un stylo. Nous avons un portail, qui permet aux familles d’y enregistrer des informations depuis n’importe où.
La Syrie mettra beaucoup de temps et la crise migratoire est liée au problème syrien. Il n’y a pas que les disparus du régime d’Hafez al-Assad, ils sont 17 000, il y a aussi ceux de la guerre en cours, ils sont au moins 40 000, ceux de la crise migratoire, dont le nombre est inconnu, ceux du trafic d’êtres humains. En Bosnie, nous avons pu collecter des informations de près de 100 000 familles, et c’est ce que nous voulons faire en Syrie et sur la crise migratoire.
Votre organisation se propose d’intervenir dans la crise migratoire. Qu’est-ce qu’elle pourrait apporter ?
Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), sur les 7 milliards d’habitants de la planète, 1 milliard est en déplacement. Et s’ils se déplacent, ils sont en-deçà des radars. Concernant la crise européenne, il est important de développer des mécanismes, d’aider l’Italie, la Grèce et d’autres Etats européens. Les familles fuient le conflit en Syrie, ou les persécutions dans la corne de l’Afrique. S’ils sont ici, en Europe, ils ont des droits. Plusieurs Syriens demandent d’ailleurs des réponses concernant leurs enfants disparus après leur arrivée en Europe, et se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Près de 10 000 enfants ont disparu. Où sont-ils ? Il n’y a pas, aujourd’hui, de mécanisme en place pour leur recherche. Nous avons un accord avec l’Organisation des migrations internationales (OIM), nous voulons travailler avec Frontex, Interpol, le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), les différentes institutions qui sont au front, traitant de cette question, et aussi avec les Etats qui ont à gérer cela, comme l’Italie ou la Grèce. Nous n’en sommes qu’au début. Nous avons un accord avec l’Italie, mais pas de budget, c’est sur le bureau de l’Union européenne. Nous fonctionnons avec un budget de 6 millions d’euros par an, c’est peu. Mais nous avons réduit les coûts, particulièrement concernant les tests ADN. Nous essayons d’éliminer les « non » politiques, en expliquant que cela ne coûte en fait pas si cher. Cela concerne la bonne gouvernance. Cela concerne des citoyens qui ont été abusés et cela peut permettre de bâtir de nouveaux ponts avec les survivants, et assurer leurs droits à la justice et la vérité. Les nouvelles technologies permettent de voir les marqueurs génétiques, vous pouvez voir de quelle région du monde une personne vient. Si vous recevez, par exemple, un échantillon post mortem de l’Italie, vous pourrez dire si cette personne vient d’Afrique centrale ou d’Afghanistan, ce qui aide lorsque vous voulez retrouver les survivants. L’Italie a 8000 migrants disparus, est complètement débordée à essayer de les identifier. Mais s’ils nous donnent des échantillons sanguins, par exemple, nous pouvons avoir leurs profils dans nos bases de données, et nous pouvons commencer le processus pour tenter de croiser le profil génétique de personnes décédées avec les familles de disparus. Cela prendra du temps. L’exercice ne consiste pas simplement à chercher la personne, cela concerne, au final, les vivants. Trouver cette personne, l’identifier, ce n’est pas seulement permettre le deuil, c’est permettre aux proches d’accéder à des droits, comme la justice, la vérité et la réparation.
Vous avez participé à plusieurs procès devant le Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, notamment l’affaire contre Radovan Karadzic, l’ex chef politique des Serbes de Bosnie, quels enseignements en tirez-vous ?
C’était une étape importante, cette coopération avec le tribunal pour l’ex Yougoslavie. Nous avons fourni des preuves dans 30 procès. Mais dans de nombreuses parties du monde, les familles sont menacées, et elles ont peur de déclarer des personnes disparues. Nous allons aussi passer un accord avec le procureur de la Cour pénale internationale le 7 juillet prochain, du même type que celui que nous avons passé avec le tribunal pour l’ex-Yougoslavie.
Vous évoquez, dans vos travaux, la difficulté à faire comprendre aux Etats l’importance de l’impartialité dans les recherches des disparus. Pouvez-vous expliquer ?
Les Etats trouvent difficile de rester impartial en recherchant les personnes disparues sans égard pour leur origine ethnique, religieuse, politique, leur genre, leur rôle dans le conflit. En Libye, nous avons eu un problème au départ, il y avait une commission des disparus, pendant le premier gouvernement de transition. Mais ils ont dissous cette commission et créé un ministère des martyrs et des disparus. Qui sont les martyrs ? Nous leur avons dit que nous pouvons travailler ensemble s’ils garantissent qu’ils chercheront tout le monde, sans égard de savoir s’il s’agit ou non de martyrs. Et nous avons reçu ces assurances. C’était clé en Bosnie. Nous avons aidé à la mise en place d’un institut qui permet à l’Etat de chercher les disparus, sans souci de leurs origines ou de leur rôle pendant le conflit. Il y a encore des personnes qui disent, ‘pourquoi devrions-nous chercher les soldats disparus ? Ceux qui ont tué nos familles ?’ Et ce sera la même chose demain, en Syrie. Le fils d’un combattant de l’EI cherchera son père, et nous devrons le trouver. Les Etats peuvent vouloir trouver certains disparus et pas d’autres, mais lorsque vous lancez les recherches, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir. Vous gérez des restes de squelettes. Et c’est la beauté des analyses ADN : on peut prouver les faits en se basant sur la science. En Bosnie, c’est intéressant de voir que le narratif du déni change au fur et à mesure qu’apparaissent les faits. Nous pouvons dire que nous avons identifié 7000 personnes à Srebrenica. Mais ce que nous voulons, c’est que l’Etat le dise, que justice passe, que les survivants puissent revendiquer leurs droits. C’est la finalité de tout cela.