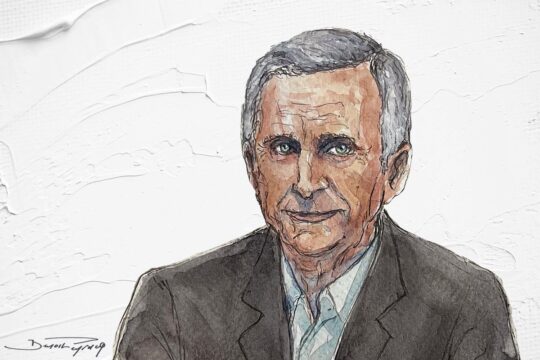LES GRANDS ENTRETIENS JUSTICE INFO
Philip Grant
Directeur de TRIAL International
Philip Grant, directeur de TRIAL International, une ONG suisse créée il y a 20 ans, parle à Justice Info du développement de la compétence universelle, de la valeur des procès nationaux en République démocratique du Congo, et de la façon dont il voit l'avenir de la justice internationale.
JUSTICE INFO : La compétence universelle se développe depuis une vingtaine d'années, et elle semble avoir gagné du terrain ces dernières années. Qu'est-ce qui, selon vous, la rend plus attractive aujourd'hui ?
PHILIP GRANT : J'aime à dire qu'il y a eu différentes périodes : la compétence universelle 1.0, puis 2.0, et maintenant nous sommes, je pense, en 3.0. Je dirais que la période 1.0 a été marquée par le précédent Pinochet [en 1998, l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet a été arrêté au Royaume-Uni sur la base d'un mandat d'arrêt émis par un juge espagnol, NDLR]. Il s'en est suivi un flot de poursuites visant des suspects de haut niveau - présidents, ministres, chefs des armées, etc. -, des dossiers qui n'avaient probablement aucune chance d'aboutir et qui ont déclenché au bout d'un certain temps une réaction politique forte de la part de grandes puissances, notamment les États-Unis, Israël et d'autres. Cette période était une sorte de foire d'empoigne où tout était possible, du moins en théorie, et elle a conduit à la compétence universelle 2.0, qui en a été le contrecoup - des changements dans la législation en Espagne, en Belgique, en Suisse et ailleurs, et beaucoup de pression de la part des pouvoirs politiques -, ce qui a donné lieu à très peu de cas concrets. Et puis, il y a dix ans, je dirais que nous sommes entrés dans la compétence universelle 3.0.
Les raisons, je suppose, sont multiples. De nombreux pays ont transposé le statut de la Cour pénale internationale (CPI) dans leur législation nationale et se sont dans une large mesure dotés d'une compétence extraterritoriale pour ces crimes. Il y a eu la création d'unités [nationales] chargées des crimes de guerre et la mise en place d’instances de coordination comme le Genocide Network. Il y a eu aussi, dans une certaine mesure, la spécialisation des ONG, qui ont pu se rendre sur le terrain et revenir avec des preuves nombreuses – ce qu’il faut du moins pour ouvrir une enquête. Et puis il y a eu le flux de réfugiés en provenance de Syrie qui a probablement changé la dynamique. Bien sûr, il y avait beaucoup de réfugiés, mais aussi des auteurs de crimes.
C'est donc un mélange de différents éléments qui a préparé le terrain du renouveau de la compétence universelle.
Il y a aussi le fait que la CPI, qui était perçue, au moins au début, comme l'institution qui rendrait justice aux victimes, n'a pas répondu aux attentes. C'est donc un mélange de différents éléments qui a préparé le terrain du renouveau de la compétence universelle.
Quelles sont, selon vous, les limites inhérentes à ce concept ?
Je pense qu'il y a des limites perçues et des limites réelles. Certains pensent que la compétence universelle est un concept néo-colonial, qu'il est impossible pour un juge étranger de comprendre ce qui se passe dans un pays lointain, où se trouvent toutes les preuves, et qu'il y a toutes ces barrières culturelles. Mais il y a beaucoup d'affaires dans d'autres domaines - la corruption impliquant des fonctionnaires étrangers, les mutilations génitales féminines, par exemple - où vous devez enquêter en dehors de vos frontières et qui soulèvent des questions culturelles et religieuses. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une limite véritable.
Une autre limite, qui est aussi un peu perçue mais qui pourrait être plus réelle, est le fait que la compétence universelle a du mal à s'attaquer aux puissants. Si votre projet est de poursuivre les George W. Bush d'aujourd'hui, je pense que oui, il y a une limite. Mais à un moment donné - nous parlons en années, voire en décennies - nous y arriverons. Nous commençons à voir dans certains de ces dossiers des ministres de l'Intérieur arrêtés, des vice-présidents de pays placés sous enquête. Nous voyons également des dirigeants d’entreprises ciblés, comme ce dirigeant Suisse dans l'affaire Lundin. Je pense donc qu'il y a un changement.
Mais je pense que l'une des principales limites que l'on constate est que l'État dont un ressortissant est visé par la procédure judiciaire tente clairement de s'en prendre aux témoins, aux victimes. Il est très difficile de protéger les victimes qui résident dans le pays où les crimes ont été commis si vous êtes l'autorité de poursuite et que vous voulez donner des garanties qu'elles seront en sécurité. Prenons l'exemple de l'Iran. Lorsque, en guise de représailles, l'Iran décide d'enlever des ressortissants suédois sur son territoire et de prétendre qu'ils ont fait de l'espionnage ou autre, cela compromet le processus et le rend très difficile.
À quelle affaire faites-vous référence ?
Je pense à l’affaire Hamid Noury [un ancien responsable de prison iranien jugé pour crimes de guerre en Suède]. Le ministre iranien des Affaires étrangères affirmait tous les deux jours que la Suède devait le libérer immédiatement et un étranger suédois a été arrêté en Iran, à peu près au moment du jugement [Noury a été condamné à la prison à vie le 14 juillet pour son rôle dans la torture et l'exécution massive de prisonniers dans les années 1980].
Une autre limite, peut-être plus théorique, serait celle d’avoir des poursuites qui ne s'en prendraient qu'à une seule partie dans un conflit, et surtout contre la partie la plus faible. Nous pourrions prendre la Turquie et le PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan, un mouvement de guérilla politique et armé], le Sri Lanka et les combattants tamouls, ou même aujourd'hui les Russes et les Ukrainiens. C'est ancré dans le concept qu'il pourrait y avoir un risque de ce genre.
Je pense que nous évoluons doucement dans une direction plus positive. En termes de tendances, nous allons voir des poursuites arriver également contre des acteurs économiques occidentaux.
N’est-il pas vrai que ce ne sont que des individus n’étant pas en position de force, issus de pays pauvres ou d’États parias qui se retrouvent soumis à la compétence universelle ? Par exemple, Anwar Raslan qui a quitté la Syrie après avoir servi le régime d'Assad.
Par définition, le système comporte des limites. Vous ne pouvez généralement pas poursuivre un chef d'État, un ministre des Affaires étrangères ou un chef de gouvernement en exercice. C'est tout simplement impossible d'un point de vue juridique. Ensuite, il faut mettre la main sur le suspect à un moment donné, ce qui est également difficile.
Je pense que nous évoluons doucement dans une direction plus positive. En termes de tendances, nous allons voir des poursuites arriver également contre des acteurs économiques occidentaux. L'affaire Lundin en Suède, par exemple, où un cadre suisse sera traduit en justice sur la base de la compétence universelle pour des crimes de guerre présumés commis au Soudan, est quelque chose qui ne pouvait même pas être imaginé il y a quelques années. Il s'agit d'un non-résident et d'un non-citoyen de la Suède qui a commis des crimes à l'étranger. Et la Cour suprême suédoise a récemment décidé que le lien est suffisant pour rendre cette affaire possible devant les tribunaux suédois.
Y voyez-vous un signe que les dirigeants d'entreprise pourraient être de fait beaucoup plus vulnérables à ce type de poursuites que les hommes politiques ?
Ce que j'essaie de comprendre, ce sont les tendances. Nous avons cessé d'essayer d'attraper les gros bonnets pour construire un système durable où une question à la fois, un cas à la fois, sont résolus. Les questions d'immunité - comme dans le cas de Khaled Nezzar [ancien ministre algérien de la Défense] ici en Suisse - doivent être réglées pour que vous puissiez, à un moment donné, poursuivre les George W. Bush de demain.
La compétence universelle n'est pas un substitut aux procès équitables qui se déroulent sur le terrain, c'est un substitut à l'absence de procès.
Revenons à l'opinion « perçue » selon laquelle la compétence universelle est post-coloniale. On a reproché à des tribunaux internationaux comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda d'être trop éloignés des réalités du pays et de son histoire. Pourquoi cette critique ne s'appliquerait-elle pas aux procès de compétence universelle, alors que nous constatons dans nombre d’entre eux un faible niveau de connaissance et de compréhension chez les personnes chargées de juger les individus ?
Eh bien, c'est une observation un peu large. Mais si vous faites allusion au fait que ces procès sont plus légitimes lorsqu'ils ont lieu sur le terrain, je suis d'accord. La compétence universelle n'est pas un substitut aux procès équitables qui se déroulent sur le terrain, c'est un substitut à l'absence de procès. Ces affaires ne sont pas traitées au niveau national. Cela fait donc partie de la compréhension de la compétence universelle - non pas seulement comme un substitut, mais comme un moyen de combler un immense fossé d'impunité. Et ce que nous entendons de la part de toutes les victimes avec lesquelles nous avons travaillé sur des cas de compétence universelle, c'est qu'elles nous disent nous faisons bien plus confiance à votre système qu'au nôtre pour traiter ces dossiers.
Si vous disposiez d'un système judiciaire libérien opérationnel, doté d'une expérience, d'une expertise et d'un palmarès dans le traitement des crimes de guerre libériens, personne ne dirait que la France doit s'occuper de ces affaires. Tout le monde serait très heureux qu'elles soient traitées au niveau national. Si vous avez des affaires en Suisse et en France, cela indique l'absence de justice au Liberia.
La Suisse est l'un des 15 pays où des parquets nationaux ont mis en place une unité spéciale pour recueillir des preuves auprès des réfugiés en vue d'éventuelles poursuites concernant la guerre en Ukraine.
Je pense qu'elle accélère ce renouveau de la compétence universelle. Sur le plan institutionnel, on voit beaucoup plus de références à la compétence universelle par les institutions internationales, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, les recommandations des commissions d'enquête au Conseil des droits de l'homme. La compétence universelle est mise sur la table comme un outil possible pour combler le fossé de l'impunité, et l'Ukraine lui a vraiment donné un coup de pouce. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons prendre au sérieux un certain nombre de choses, non seulement en mentionnant la compétence universelle, mais en mettant en œuvre une législation qui permettra à la compétence universelle de se déployer de manière équitable.
Prenez l'Italie, par exemple, le pays où le Statut de Rome [de la CPI] a été adopté. L'Italie n'a toujours pas mis en œuvre le Statut de Rome. C'est donc un peu une blague. Si vous voulez être sérieux au sujet de la responsabilité juridique, vous devez améliorer votre système juridique assez rapidement, vous devez travailler à la mise en place d'unités de crimes de guerre qui auront l'expertise nécessaire pour traiter ces dossiers. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais j'espère que la crise ukrainienne poussera un certain nombre d'États à améliorer leur cadre juridique et leur capacité institutionnelle.
Le rôle des ONG pourrait-il être moindre, du fait que la volonté politique de tous ces États d'engager des poursuites concernant les crimes commis en Ukraine est plus forte ?
Je pense que vous avez raison, et c'est une question à deux volets. La première concerne la capacité des ONG à être réactives en l'absence de suspects susceptibles de déclencher une réaction de leur part. En dehors d'un ou deux transfuges, nous ne voyons pas beaucoup de personnes qui pourraient être la cible d'enquêtes des ONG. Et dans une certaine mesure, nous voyons également des États dire nous sommes en charge maintenant, nous n'avons plus autant besoin de vous. Mais c'était la première réaction et il y a probablement maintenant plus de discussions, surtout si vous pensez aux ONG ukrainiennes, bien sûr, qui font un énorme travail d'enquête et de collecte de preuves.
En ce qui concerne les ONG internationales, il y avait une certaine concurrence en jeu. Je constate aujourd'hui une légère évolution vers une plus grande coopération et, à mesure que la guerre s'éternise, la nécessité d'être ouvert à diverses solutions, y compris la compétence universelle ou la compétence extraterritoriale.
Voyez-vous un risque que toute l'attention portée à l'Ukraine se fasse au détriment d'autres dossiers de compétence universelle ?
Je pense qu'il y a un risque d'enlever des ressources à d'autres dossiers et situations pour porter toute l'attention sur l'Ukraine, oui. La Suisse met en place une unité sur l'Ukraine - pourquoi seulement l'Ukraine ? Mais à long terme, cela s'équilibrera. Les bureaucraties ont aussi besoin de légitimer leur existence, donc même si l'Ukraine s'éteint à un moment donné, ces groupes de travail, ces mécanismes, la révision des cadres juridiques resteront utiles.
Pensez-vous qu'il soit judicieux de créer un tribunal spécial pour le crime d’agression, comme le préconisent certains pour l'Ukraine ?
Avec le cadre juridique et les institutions que nous avons en place, c'est à peu près un crime sans tribunal. La question est donc de savoir si ce crime doit avoir un tribunal. Et je ne sais pas. Je pense que cela dépend si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié vide serait le risque d'avoir un tribunal en place qui serait politisé, uniquement là pour juger l'agresseur russe et qui disparaîtrait une fois que ce serait fait. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions ouvertes en ce qui concerne les autres grandes puissances qui auraient pu prendre part à des agressions dans le passé.
Le verre à moitié plein ressemble davantage au précédent de Nuremberg. Il s'agissait d'une justice de vainqueurs, mais ce que l'on constate en regardant en arrière, c'est un ensemble de principes très puissants qui ont ensuite contribué à jeter les bases des efforts de responsabilisation pour les décennies à venir. Si une telle cour est mise en place, sera-t-elle en mesure de rendre des jugements et des décisions qui ne s'appliqueront pas seulement à la Russie, mais qui reviendront à un moment donné hanter les autres grandes puissances ?
Si vous regardez à court terme, c'est une entreprise assez risquée en termes d'impartialité et d'indépendance. Mais à plus long terme, on peut penser qu'une telle cour pourrait apporter un grand nombre de développements juridiques positifs.
Bien qu'il ne s'agisse pas de juridiction universelle, une grande partie du travail effectué par TRIAL consiste à soutenir les procès locaux en République démocratique du Congo (RDC). Il s'agit d'un processus assez important si l'on considère que plus de 50 personnes ont été jugées pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans un pays où l'environnement peut difficilement être plus hostile à la tenue de procès. Avez-vous tiré des enseignements spécifiques de cette expérience ?
Nous avons été très actifs, principalement dans la province du Sud-Kivu, un peu au Nord-Kivu et maintenant de plus en plus au Kasaï-Central, donc je ne brosse pas un tableau complet de ce qui se passe en RDC. Cela dit, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que la justice soit rendue, mais pas de manière parfaite. Si vous vous efforcez d'avoir des procès parfaits qui répondent à toutes les conditions légales, cela n'arrivera pas, donc vous devez faire avec ce que vous avez.
C'est un grand puzzle aux multiples pièces. Tout d'abord, il faut disposer d'une législation nationale adéquate - ce qui n'est pas spécifique à la RDC - mais il faut aussi que les autorités s'engagent au moins à mettre en place les institutions nécessaires à la tenue de ces procès. Et dans la plupart des cas dont nous nous occupons, les communautés locales n'ont peut-être jamais vu un juge, un procureur, parfois même un officier de police en leur sein. Il s'agit donc d'avoir des institutions qui sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour se rendre physiquement là où les crimes ont été commis.
Une stratégie doit être mise en place, et c'est une stratégie qui est partagée par les différents acteurs, tant internationaux que nationaux. Il s'agit d'ONG et d'autorités qui se réunissent autour d'une table pour discuter des dossiers les plus urgents et les plus importants, des contraintes matérielles, du paiement des salaires, de l'installation de tribunaux dans des lieux spécifiques, de la sécurité et des soldats qui peuvent garder les locaux, de la garantie que les victimes soient accompagnées lorsqu'elles viennent au tribunal et protégées pendant les procès.
Il s'agit d'un certain nombre d'éléments qui doivent être réunis au bon moment et au bon endroit pour que ces affaires se concrétisent, et parfois c'est un peu de technique, d'expertise et de flair juridiques qui feront d'une affaire particulière, un succès. Parfois, ce sont simplement des avocats intelligents qui veillent à ce que les procureurs disposent des preuves et de la stratégie nécessaires pour aller de l'avant.
Faire d’un tribunal militaire un lieu de créativité est un véritable exploit, et ce n'est pas ce que nous espérions au départ. Mais nous avons été témoins d'une certaine créativité de la part des tribunaux militaires congolais.
Pensez-vous qu'il en ressortira une jurisprudence intéressante en ce qui concerne les droits des populations autochtones et les questions environnementales ?
Oui. Faire d’un tribunal militaire un lieu de créativité est un véritable exploit, et ce n'est pas ce que nous espérions au départ. Mais nous avons été témoins d'une certaine créativité de la part des tribunaux militaires congolais. Par exemple, les parlementaires locaux bénéficient d'une immunité de poursuites fondée sur le cadre juridique national, mais les tribunaux ont obtenu que cette immunité soit levée en se référant au statut de la CPI. Ou encore, en termes de réparations, un tribunal militaire a soudainement déclaré que le gouvernement devait être tenu responsable de son incapacité à protéger et à anticiper les attaques des groupes rebelles, de sorte que des affaires contre des commandants rebelles se terminent par le versement de réparations par le gouvernement, qui n'a pas su prévenir ou fournir une aide médicale aux victimes.
On peut donc dire que même si ce n'est pas, pourrait-on dire, le rêve d'un universitaire occidental, il y a beaucoup de choses qui émergent et qui devraient susciter beaucoup d'intérêt.
Et puis, au milieu de nulle part en RDC, vous avez des tribunaux militaires qui essaient d'être créatifs en matière d'environnement. Nous avons vu des affaires récentes dans lesquels la destruction de l'environnement faisait partie de la stratégie des procureurs. C'est arrivé dans l'une des affaires que nous avons eues au Sud-Kivu. En fin de compte, malheureusement, les crimes contre l'environnement n'ont pas été reconnus comme un crime de guerre mais comme une violation du droit national. Mais il y a une jurisprudence qui est en train d'émerger selon laquelle les groupes rebelles ne peuvent pas commettre des crimes contre l'environnement, en plus de tous les autres crimes qu'ils commettent. On peut donc dire que même si ce n'est pas, pourrait-on dire, le rêve d'un universitaire occidental, il y a beaucoup de choses qui émergent et qui devraient susciter beaucoup d'intérêt.
Êtes-vous un peu frustré par le fait que ces procès ne soient pas reconnus comme une jurisprudence significative, importante et précieuse parce qu'ils sont éloignés et ne correspondent pas à ce que les facultés de droit et les juristes internationaux apprécient ?
Nous sommes probablement en partie responsables de cela, nous devrions probablement mettre plus de moyens pour faire passer le message. Mais oui, ce qui est souvent regrettable, c'est le manque de considération des jugements nationaux par rapport aux internationaux. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce qui se passe au niveau local. Et c'est la beauté de la loi avec ces dossiers. Ils ne sont pas seulement référencés par des acteurs extérieurs, mais ils font également force de loi dans le pays s'ils sont considérés comme bien jugés. Et il est ainsi possible que d'autres provinces de la RDC les utilisent comme des précédents.
Vous ne pouvez pas mettre KO un ancien dictateur par le biais d'un processus de réparation.
Les avocats internationaux et les organisations internationales des droits humains ne semblent plus tellement s’intéresser aux réparations. Alors que, il y a quelques années, avec le déclin de la justice pénale internationale, une plus grande attention a semblé leur être accordée. Observez-vous cela ?
C'est un peu la réflexion, peut-être d'un point de vue juridique, que les réparations ont moins d'impact que les procès pénaux dans le sens où elles ne donnent pas lieu à des décisions qui s'imposeront comme des principes et des précédents. Vous ne pouvez pas mettre KO un ancien dictateur par le biais d'un processus de réparation.
Nous avons mis l'accent sur les réparations, et notamment sur la tentative d'obtenir des réparations dans le cadre du processus pénal. Nous avons réussi à le faire en Bosnie, en permettant aux victimes de violences sexuelles de réclamer des réparations au cours du procès pénal. Mais je suppose que l'un des aspects est le fait qu'une fois que vous obtenez vos mesures de réparation, vous devez souvent rejuger l'affaire juste pour qu'elle soit appliquée. C'est donc un autre obstacle, qui prend souvent beaucoup de temps. Parfois, vous obtenez des réparations en fin de compte, qu’elle soit financière, médicale, etc. Mais c'est quelque chose que nous avons probablement un peu peur de promettre, parce que c'est difficile à obtenir.
Nous devons donc mettre en place d'autres systèmes de réparation, des mesures plus administratives que pénales. Je pense à un Fonds mondial pour les victimes de violences sexuelles. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'au niveau individuel, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il s'agit de bien plus que de condamner le méchant à une peine de prison.
Ce qui me fascine, ou ce à quoi nous devons réfléchir, c'est le deuxième cercle d'auteurs en dehors des auteurs directs : tous les facilitateurs, ceux qui, dans les entreprises et même dans le domaine culturel, rendent possible la perpétration des crimes
Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment dans le domaine de la justice internationale ?
Nous avons mentionné certaines choses comme la protection de l'environnement dans les conflits. Je pense également que la question des mercenaires et des sociétés militaires privées va probablement gagner en importance à l'avenir. Ce qui me fascine, ou ce à quoi nous devons réfléchir, c'est le deuxième cercle d'auteurs en dehors des auteurs directs : tous les facilitateurs, ceux qui, dans les entreprises et même dans le domaine culturel, rendent possible la perpétration des crimes en achetant, par exemple, des objets culturels qui ont été pillés ou en permettant à des groupes d'accéder aux marchés mondiaux et de gagner de l'argent grâce au pillage qui alimentera ensuite le conflit. Il y a un champ énorme qui doit être ouvert sur la façon d'atteindre les facilitateurs.
Et puis une question, et là je pense plus en termes d'outils, est de savoir ce que nous pouvons faire avec les nouvelles technologies, pas seulement pour documenter et sauvegarder les preuves, mais pour suivre les suspects, les centaines, probablement les milliers d'auteurs résidant sur le territoire de pays qui pourraient exercer la compétence universelle. Seul un nombre très limité d'entre eux est porté à l'attention des autorités, par le biais d'ONG ou d'autres. Ainsi les nouvelles technologies pourraient-elles permettre de mieux localiser les suspects ? C'est une chose que nous découvrirons probablement bientôt.

Philip Grant est le fondateur et le directeur de TRIAL International, une ONG qui lutte contre l’impunité basée à Genève, en Suisse, depuis 2002. Il est titulaire d'une licence en droit, d'un master en droit international humanitaire et d'un doctorat en droit constitutionnel. Il vient de recevoir un diplôme honorifique de l'Université suisse de Bâle en reconnaissance de son travail à TRIAL International. Avant de fonder TRIAL, il a travaillé comme avocat dans un cabinet d'avocats genevois. Il est actif depuis son adolescence dans diverses organisations travaillant sur les questions des droits humains, du racisme, des réfugiés et du droit à l'objection de conscience.