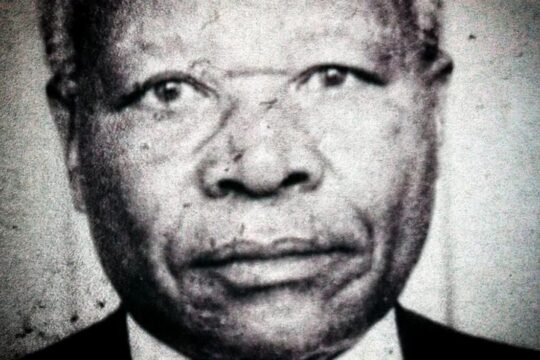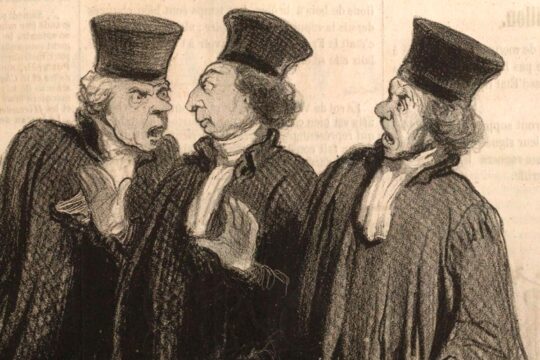Quand un procès n'est-il plus un procès ?
Ce 25 septembre 2025, cela fait 1092 jours que le procès de Félicien Kabuga s'est ouvert dans les locaux du Mécanisme international chargé des fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (MTPI), à La Haye. Ce jour-là, le jeudi 29 septembre 2022, j’étais entrée dans la salle d'audience n° 1 – dans le bâtiment qui abrite aujourd'hui le MPTI, mais qui était auparavant le siège du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) – au milieu d'une foule de journalistes, de stagiaires en droit, de diplomates et d'autres membres du public. J'étais alors en troisième semaine d'un doctorat sur les récits historiques au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Aujourd'hui, trois ans plus tard, j'ai presque terminé ce doctorat. Bon nombre des stagiaires ont sans doute déjà bien avancé dans leur carrière. Certains des journalistes de 2022 écrivent maintenant sur les mandats d'arrêt à l'encontre de hauts dirigeants russes, israéliens et afghans. Ils couvrent ce que beaucoup considèrent comme l'effondrement imminent de la Cour pénale internationale (CPI), sous le double poids des sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et de ses propres défis et contradictions. D'autres envisagent la mort potentielle du droit international lui-même. Et pourtant, Félicien Kabuga est toujours assis là où il était il y a plus de 1000 jours : au quartier pénitentiaire des Nations unies, à environ 10 minutes en voiture (ou à vélo) de la salle d'audience.
Son procès a pris fin à trois reprises : une première fois en mars 2023, lorsqu'une équipe de trois experts médicaux a jugé qu'il était inapte à être jugé en raison de sa démence ; une deuxième fois en juin 2023, lorsqu'une équipe de trois juges a décidé que son procès proprement dit prenait fin, mais se poursuivrait sous la forme d'un « examen des faits » ; troisièmement en août 2023, lorsqu'une équipe de cinq autres juges a rejeté cette impossible suggestion et imposé une « suspension indéfinie » du procès de l'un des cerveaux présumés du génocide au Rwanda en 1994.
Et pourtant, Kabuga est toujours là.
Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi d'assister en personne à cette conférence de mise en état en particulier. Les 780 jours qui se sont écoulés depuis que la Chambre d'appel a déclaré la suspension indéfinie du procès ont été émaillées de telles conférences. Au cours de ces sessions, chacun dans la salle d'audience y exprime invariablement sa frustration que Kabuga soit toujours là où il est. Une pause s’ensuit (du moins du point de vue du public), jusqu'à ce que nous nous réunissions à nouveau pour entendre cette même frustration, et Kabuga est toujours assis à sa même place. Peut-être qu'après avoir assisté à l'audience in absentia du chef de la LRA, Joseph Kony, à la CPI deux semaines plus tôt, je n'avais pas encore eu ma dose de procédures juridiques internationales originales. Ou c'était peut-être la fin imminente de ma thèse, bornée par l'odyssée judiciaire de Kabuga, qui me rendait nostalgique. Quoi qu'il en soit, j'ai une fois de plus franchi le scanner de sécurité et on m'a remis mon ticket « Visiteur » imprimé individuellement : ici, pas de laissez-passer électronique plastifié comme à la CPI, la sœur plus glamour et plus médiatisée du MTPI, un peu plus loin dans la même rue.
Déambuler dans le hall du Mécanisme en 2025 donne l'impression de faire un voyage dans le temps. On y trouve des affiches avec des QR codes (alors que les téléphones soient interdits) annonçant des expositions en ligne des archives du TPIY et du TPIR, ou sur les enfants dans les conflits. On y trouve aussi des dessins d'enfants encadrés, réalisés lors d'un atelier de sensibilisation du TPIY au Festival des enfants de Sarajevo en 2014. Dans le coin le plus éloigné est accrochée une affiche spectaculaire : « Porter en justice les criminels de guerre et rendre justice aux... ». Le mot « victimes » est caché derrière un écran d'ordinateur hors service. Dans le grand atrium, où les observateurs du procès passent par un autre scanner de sécurité, au-delà de photos des juges du MTPI et du TPIY et en montant quelques marches en marbre poli jusqu'à la salle d'audience 1, une autre bannière est suspendue. En haut « Nuremberg 1945 », en bas « La Haye 1993 ». Avec une photo des deux prétoires. Et en rouge, à travers : « Le premier tribunal international pour crimes de guerre depuis Nuremberg et Tokyo ». Mais il est assez difficile de distinguer les détails sur les photos, car les lumières du grand atrium sont éteintes. Dans un autre coin, une table de mixage cassée est recouverte de plusieurs autocollants portant la mention « hors sevice ».
Si les locaux du Mécanisme, et en particulier la salle d'audience n° 1, semblent blanchis sous le harnais par rapport au showroom IKEA rutilant de la CPI, c'est parce qu'ils le sont. Ils ont littéralement senti le poids de la justice et de la violence dans une mesure bien plus importante que le tribunal permanent. Le siège du MTPI est peut-être un bâtiment qui semble poussiéreux ou vieilli. Mais il a une histoire. Depuis 1993, il a vu défiler certains des noms les plus tristement célèbres de la violence et du génocide en ex-Yougoslavie, notamment l'ancien président serbe Slobodan Milošević et les génocidaires condamnés de Srebrenica, dont Ratko Mladić et Radislav Krstić. Cette salle a également vu défiler une pléiade de juristes, dont beaucoup ont continué à travailler à l'avant-garde de la justice pénale internationale. Et parmi eux figure l'homme qui, ce 25 septembre, se tient seul vêtu d'une robe rouge, derrière le banc : le juge Iain Bonomy.
Quand un accusé n'est-il plus un accusé ?
On est rappelé à la réalité lorsque la voix douce et chantante de Bonomy nous fait savoir que ses collègues Mustapha El Baaj et Margaret deGuzman se joigneront à nous par liaison vidéo, tout comme Kabuga lui-même. Dans la galerie, on ne peut pas le voir car les écrans qui nous montrent normalement la salle d'audience, y compris ses participants virtuels, sont éteints. Alors que la voix du procureur Rupert Elderkin, lui aussi présent virtuellement, parvient à mes oreilles pendant les présentations des parties, mon casque s'éteint tout seul. Je me rends vite compte que je dois appuyer sur un bouton toutes les 30 à 45 secondes pour éviter le problème et, après quelques minutes de confusion à passer du canal anglais à celui en français, j'opte pour appuyer sur le bouton volume. Le reste de la conférence de mise en état me parvient donc comme si j'étais assis sur une balançoire : les voix se font progressivement plus fortes, puis plus faibles. Au cours d'une pause à huis clos, j'apprends dans un murmure que le problème touche toute la galerie du public et que notre salle est remplie de casques en panne.
La conférence de mise en état est à la fois étonnamment publique et étonnamment informative. Le juge Bonomy semble avoir une aversion personnelle mal dissimulée pour l'inefficacité de la justice et les huis clos, ce qui le rend instantanément populaire parmi ceux d'entre nous qui se trouvent dans la galerie. Il commence par nous donner, à nous, « le public », un résumé des dernières nouvelles sur le travail qui se déroule « sans relâche » dans les coulisses. Dans des rapports déposés en avril et juin de cette année, un « expert en médecine de soins intensifs » a jugé que Félicien Kabuga n'était « globalement pas apte à prendre l'avion ». Étant donné que, en 2022, il n'était pas apte à être transporté par avion à Arusha (Tanzanie) pour un procès plus proche du lieu de ses crimes présumés, ce n'est guère surprenant. Mais ces mises à jour nous permettent de mieux connaître l'état de santé déclinant de cet homme aujourd'hui âgé de 90 ou 92 ans. L'expert en soins intensifs a noté que la « fragilité physique, les maladies concomitantes » et les « médicaments » de Kabuga rendraient très risqué un vol vers un lieu aussi éloigné que le Rwanda. Le procureur, dans un élan de désespoir ou d'optimisme, semble penser que ce risque peut être atténué. Bien que les juges n'aient pas encore pris de décision sur le rapport de juin 2025, l'équipe d'Elderkin a déposé un dossier, le 9 septembre, réaffirmant que la meilleure (et seule) option pour Kabuga était le Rwanda. Bonomy, avec un ton ironique caractéristique, tient à préciser que ce dossier est « sans utilité » et que, « s’il s’agit d’une requête, elle est rejetée ». Nous devons tous, y compris Elderkin, d’abord attendre la décision des juges sur ce rapport.
Deux mises à jour inattendues et plus inhabituelles s’ensuivent. Tout d'abord, le greffe a informé la Cour qu'il est en train de récupérer les avoirs gelés de Kabuga afin de payer les frais de justice. Malheureusement, deux réunions prévues début septembre, l'une « de haut niveau » et l'autre « technique », avec l'État non nommé dans lequel se trouvent les avoirs de Kabuga, ont été annulées à la dernière minute en raison de la « situation politique actuelle » de cet État. Le mystère entourant cette annonce est quelque peu dissipé par les murmures qu’on entend – « ça doit être la France » - et qui parcourent la salle.
Ensuite, nous entendons Emmanuel Altit, l'avocat de Kabuga, parler de deux États européens ayant initialement rejeté la demande de Kabuga d'être libéré sur leur territoire, mais avec lesquels des discussions sont actuellement en cours. L'un de ces États n'est pas nommé, mais le second – la France – est évoqué publiquement pour la première fois. Altit déclare que la France a récemment rejeté la demande de Kabuga par voie judiciaire, affirmant que Kabuga, en tant qu'individu, n'était pas habilité à présenter une telle demande et que celle-ci devait être faite par l'intermédiaire du Mécanisme, en tant qu'« entité diplomatique ». Altit s'attend à ce que cette décision soit infirmée en appel, mais cette procédure pourrait prendre encore 8 à 10 mois.
Fait peu coutumier dans une procédure pénale internationale contradictoire, le procureur semble dans une large mesure n’avoir aucun poids dans la tâche actuelle de la Cour : mettre enfin un terme à la situation incertaine de Kabuga. La voix désincarnée d'Elderkin n'intervient que deux fois, pour souligner chaque fois qu'il peut « être bref » et pour ne rien dire de particulier finalement, tandis que ses collègues basés à La Haye restent assis dans un silence stoïque. L'un d'eux tape sur son téléphone. Bonomy réitère que tous les acteurs de la Cour travaillent « sans relâche » pour obtenir la libération de Kabuga, et fustige « la réticence de certains États européens à l'accueillir sur leur territoire ». Quand un accusé cesse-t-il d'être un accusé ? Pour les États qui se prétendent champions de la justice internationale et de l'État de droit, il semble que l'absence de condamnation ne soit pas suffisante. Kabuga, comme les autres accusés du TPIR ayant été acquittés ou ayant purgé leur peine et qui sont désormais piégés au Niger, se voit constamment rappeler que la justice légale n'est, pour certains États, toujours pas suffisante, et que la justice politique suit son propre rythme. Si la fin approche peut-être pour Kabuga, il semble peu probable que ce soit notre dernière conférence de mise en état.
Quand un tribunal n'est-il plus un tribunal ?
Ce sera toutefois la dernière dans la salle d'audience n° 1. Alors que la procédure touche à sa fin, Bonomy annonce de manière inattendue que cette session est la dernière fois qu'une chambre de première instance siégera dans « cette salle d'audience légendaire et historique ». Les futures audiences concernant Kabuga se tiendront dans une « salle de conférence aménagée », déclare-t-il, avec un léger sourire que l’on pourrait facilement prendre pour une grimace. Sans dire ce qu'il adviendra de la salle d'audience n° 1, il conclut en évoquant les centaines de personnes qui ont travaillé dans ses murs depuis 1993 – agents de sécurité, interprètes, greffiers, juges, témoins, victimes, procureurs, avocats de la défense, accusés – « tous à la recherche de l'équité, de la justice et de la vérité ». Pour Bonomy, un tribunal est plus qu'une simple arène : il s'agit, « au fond, d'un forum où des arguments sont présentés, des preuves sont entendues et des décisions sont prises ».
Lorsque Bonomy se lève et que le rideau tombe, le public reste brièvement et inhabituellement silencieux. Puis, une vague de nostalgie déferle. Mon voisin s'exclame qu'il a passé des centaines d'heures dans cette salle à couvrir des procès. Plus loin, d'autres journalistes évoquent les personnalités qu'ils ont vues assises sur ces fauteuils qui ne seront plus jamais utilisés. « J'ai traversé ma vingtaine dans ce tribunal », dit l'un d'eux. Cette salle a décidé non seulement du droit et de la justice, mais aussi des carrières, des vies et des histoires. Après l’audience, lorsque j'ai posté un message en ligne sur l'annonce de Bonomy, j'ai reçu des réactions étonnamment émouvantes de la part d'amis, de collègues et de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Pour tous, cet espace a représenté quelque chose de plus grand, et peut-être quelque chose qu'ils craignent désormais de ne plus jamais revoir : un effort concerté et généralisé pour accomplir la « justice », quelle que soit la signification que l'on donne à ce mot.
Qu'est-ce qui fait qu'un tribunal est un tribunal ? Sans aucun doute les personnes qui le composent. Mais ces lieux où l’on débat, prouve et décide doivent tout de même être des espaces désignés, souvent imprégnés du faste et du cérémonial des lois, des traités et des règles, où les individus se réunissent dans un but précis. Les prétoires sont des espaces facilitant les interactions qui, question après question, réplique après réplique, argument après argument, requête après requête, forgent la justice pénale internationale. Ils recèlent toutes les émotions générées par ces interactions, ainsi que la difficulté de raconter, de poursuivre et de juger les violences de masse. La fermeture de la salle d'audience N° 1 du TPIY et du MTPI marque la disparition d'un tel espace, qui a porté son lot d'espoirs, d'émotions et de justice. Sera-t-elle autorisée à rester – à défaut d’être un moteur de la justice – comme un souvenir ou un témoignage du passé, à l'instar de la salle d'audience 600, à Nuremberg ? Ou disparaîtra-t-elle complètement ? Son destin pourrait être le reflet de notre époque, privée à la fois de l'aspiration à la justice de 1945 et de l'idéalisme judiciaire de 1993. Bonomy n'a pas évoqué l'avenir de cette salle d'audience. Peut-être ne le connaît-il pas.

Lucy J. Gaynor est chercheuse doctorante à l'université d'Amsterdam et au NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, examinant la construction de narratifs historiques dans le cadre des procès pénaux internationaux.