Le mois d’octobre 2025 a été marqué par un début de paix au Proche-Orient, venant ponctuer deux années de guerre à l’intensité inégalée dans l’histoire contemporaine de la Palestine, entamé au lendemain des attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien. Deux années de guerre au cours desquelles le mot « génocide », d’abord combattu, a pris chaque jour un peu plus de sens alors que se multipliaient rapports et analyses de preuves d’exactions commises par les forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza : meurtres, en grande partie de civils, empêchement de l’accès à l’aide humanitaire et affamement des Gazaouis, déplacements forcés, destructions d’infrastructures essentielles, d’écoles, d’hôpitaux et autres édifices protégés par le droit international humanitaire.
La paix peut-elle effacer l’ardoise des fournisseurs d’armes ?
Dès janvier 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ), saisie par l’Afrique du Sud, ordonne à Israël une série de ‘mesures conservatoires’ pour prévenir la commission d’actes relevant de la Convention de 1948 sur le génocide, ayant constaté « qu’il y a urgence, en ce sens qu’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits qu’elle a jugés plausibles ». La Cour réaffirmera par la suite ces mesures en les étayant à l’occasion de deux ordonnances complémentaires en mars et mai 2024. Si la CIJ ne s’est pas encore prononcée sur le fond, une commission d’enquête indépendante mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a publié un rapport le 16 septembre 2025, dans lequel elle qualifie de « génocide » les actes commis par Israël à Gaza.
Ces conclusions font écho à plusieurs autres rapports de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, sur ce qu’elle qualifie d’« anatomie d’un génocide » et d’« économie de génocide ».
La perspective, même fragile, de paix n’efface pas les crimes commis par les différentes parties au conflit. Si le mot « justice » peine à se faire entendre dans ce contexte à haute charge politique, les responsables de ces crimes devront rendre des comptes, qu’ils s’agissent des auteurs directs, ou de ceux qui leur ont fourni une aide, notamment matérielle. Cela vise tout particulièrement les entreprises ayant livré du matériel militaire ou pouvant être utilisé à de telles fins et ayant servi à la commission d’actes relevant du droit pénal international.
La poursuite pénale de tels auteurs indirects, qui plus est de personnes morales, pour de tels crimes n’est pas sans défi. Il ne suffit pas d’établir que ces acteurs ont entretenu des relations commerciales avec le gouvernement ou des partenaires militaires israéliens. Encore faut-il pouvoir établir le lien entre le matériel ou les services fournis et les actes criminels. Se posent ensuite des questions liées à la responsabilité des personnes morales (en tant que telles et pour crime de génocide) et des questions propres aux spécificités du secteur de l’armement.
Poursuivre des entreprises d’armements pour crimes internationaux ?
Cette responsabilité n’est pas nouvelle en droit international pénal. Elle s’est posée dès les procès de l’après-Seconde guerre mondiale. Si les statuts de Nuremberg n’envisageaient pas la responsabilité des personnes morales, l’idée étant que « ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes », le rôle des entreprises ayant fourni une aide matérielle au régime nazi dans la déportation et l’extermination de six millions de Juifs a bien été abordé, notamment dans le cadre du procès IG Farben. En juillet 1948, le tribunal militaire de Nuremberg a condamné plusieurs dirigeants de l’entreprise ayant fabriqué et fourni le Zyklon B – indispensable au fonctionnement des chambres à gaz – notamment pour travail forcé et mise en esclavage, mais pas pour leur participation à l’extermination en tant que telle.
Si le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) ne prévoit pas non plus de poursuites à l’encontre de personnes morales, des dirigeants d’entreprises impliqués dans la commission de crimes internationaux rentrant dans la compétence de la Cour pourraient également s’y voir traduits. En octobre, une communication a ainsi été transmise au procureur de la CPI de la part d’organisations de la société civile italienne afin de lui demander d’ouvrir une enquête à l’encontre de personnalités politiques italiennes, ainsi que du dirigeant d’un groupe italien d’aéronautique et de défense, pour complicité de crimes commis à Gaza. Leurs sont reprochés la fourniture d’armement au gouvernement israélien utilisé dans le « génocide en cours ».
Certains systèmes nationaux prévoient la responsabilité pénale de personnes morales, y compris pour les crimes internationaux. C’est le cas de la France, où est par exemple poursuivie BNP-Paribas au Soudan pour complicité de crimes de guerre. L’entreprise a déjà été condamnée en octobre 2025 par un tribunal new yorkais à verser des réparations à des réfugiés soudanais pour financement du régime d’Omar al-Bashir. Le cimentier Lafarge y fait également l’objet de mises en examen pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l’humanité s’agissant de son soutien présumé au groupe État Islamique en Syrie.
La question de l’intention, au cœur du crime de génocide
Le degré d’intentionnalité requis dépend du crime international envisagé. Il est particulièrement élevé s’agissant du crime de génocide, qui prévoit une double intention : celle de commettre les actes, et celle de détruire un des quatre groupes protégés par la Convention. Se pose une première question : celle de l’articulation de cette intentionnalité avec le mode de responsabilité qui sera retenu dans le cadre de poursuites visant des fournisseurs de matériel militaire – principalement la « complicité » même si d’autres modes peuvent être envisagés, tels que par exemple « l’entreprise criminelle commune » ou le « recel de crime international ». Selon la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda, il n’est pas nécessaire que le complice partage l’intention de l’auteur du génocide, il suffit qu’il en ait eu connaissance.
La seconde et principale question est donc bien de savoir à partir de quand, dans le contexte d’un génocide présumé dans la bande de Gaza, il n’est plus possible d’argumenter que l’on ne savait pas, que l’on ne pouvait pas savoir. Il semble que la première ordonnance de la CIJ puisse constituer un marqueur temporel objectif. Si la Cour n’a pas encore rendu de jugement sur le fond, elle a prononcé toute une série de mesures fortes destinées à prévenir la commission d’un génocide, au vu de l’urgence de la situation, et d’un « risque réel et imminent de préjudice irréparable ». Dans sa seconde ordonnance, la CIJ a néanmoins rejeté la possibilité d’ordonner aux États tiers de s’abstenir de fournir une aide matérielle, notamment militaire, à Israël, considérant que son Statut ne le lui permettait pas. Défaut de compétence ne signifie néanmoins pas défaut d’obligation.
Le rapport de la Commission d’enquête note ainsi que « depuis au moins le 26 janvier 2024, date à laquelle la Cour internationale de justice a ordonné ses premières mesures provisoires, tous les États parties à la Convention sur le génocide, ainsi que tous les autres États, ont été avisés du risque sérieux qu’un génocide était en cours ou en voie d’être commis. À ce titre, l’obligation de prévenir le génocide a été engagée du fait de la connaissance réelle ou possible de la plausibilité immédiate qu’un génocide était en train ou sur le point d’être commis. »
Par ailleurs, la plupart des entreprises concernées par de potentielles accusations de complicité de génocide à Gaza font l’objet, de par leur nature, d’une participation étatique, parfois majoritaire, rendant cette connaissance d’autant plus inévitable.
L’État qui autorise la livraison d’armes peut-il faire écran ?
En écho, un autre défi réside dans la possibilité pour la responsabilité étatique de faire écran à celle des entreprises. L’exportation de matériel militaire ou pouvant être utilisé à de telles fins fait l’objet de réglementations, qui prévoient un système d’autorisations étatiques. Le Traité sur le commerce des armes dispose ainsi qu’un « État partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques (…) s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. » Une condition similaire est prévue par le droit européen.
Si le principe semble fort, les niveaux supranationaux de régulations laissent une forte marge d’appréciation aux États. Ainsi, en dépit d’un appel d’experts onusiens à cesser toute exportation d’armes vers Israël, le Royaume-Uni considérait toujours, en septembre 2025, que la fourniture de pièces nécessaires à l’assemblage des avions de combat F-35, utilisés par l’armée israélienne pour bombarder la bande de Gaza, ne risquait pas de contribuer à la commission d’un génocide ou d’autres violations du droit international humanitaire.
Les Pays-Bas ont, quant à eux, adopté une politique différente, sous la pression de leurs tribunaux, interdisant l’exportation d’équipements des F-35 à destination d’Israël. La Cour Suprême néerlandaise est toutefois venue rappeler la marge discrétionnaire qui revenait au gouvernement dans le cadre d’exportations de matériel militaire. Le juge administratif français s’est lui déclaré incompétent pour contrôler la légalité de licences d’exportation, les considérant comme des actes de gouvernement. Un rejet similaire fait l’objet d’un appel en Allemagne, dans le cadre d’un autre conflit, celui opposant le Yémen à l’Arabie Saoudite.
Si la réglementation de l’exportation de matériel militaire rend difficile la consécration d’une complicité étatique en matière de crimes internationaux, l’autorisation étatique ne fait pas pour autant disparaître les éléments constitutifs de ces crimes et de leur complicité. Les personnes, qu’elles soient physiques ou morales, qui procèdent à l’exportation conservent leur libre arbitre, et donc la connaissance des risques que leurs exportations font encourir à une population. L’on voit dès lors mal comment le voile étatique pourrait faire écran à la responsabilité pénale.
Le second écran, contractuel, de la « diligence raisonnable »
Les réponses aux révélations de la presse ou de la société civile sur l’utilisation de matériel militaire fourni par des entreprises européennes et utilisé à Gaza font apparaître une autre forme d’écran, contractuel cette fois-ci. En alignement avec les politiques étatiques d’exportation de matériel, il serait stipulé dans les contrats conclus alors que la guerre menée par Israël à Gaza était en cours que ce matériel ne devrait en aucun cas être utilisé dans le cadre de ladite opération. Dans la même veine, les pièces et équipements encore fournis seraient selon ces entreprises exclusivement destinés à de l’équipement « non létal », par exemple des drones de surveillance – argument rapidement battu en brèche par le visionnage de vidéos d’un massacre de civils, y compris d’enfants, par ces mêmes drones.
Ces défenses font écho au principe de la diligence raisonnable, ou devoir de vigilance, en vertu duquel une entreprise doit tout mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer les violations aux droits humains que ses produits ou services pourraient occasionner. De telles obligations sont supposées être renforcées en cas de conflit armé, et l’interruption de relations commerciales avec des acteurs susceptibles de commettre de graves violations du droit international humanitaire fait partie de la palette d’actions à la portée des acteurs commerciaux. Posé au niveau international dans des instruments non contraignants (par l’Onu, ou l’OCDE) ce principe peine à s’imposer dans les systèmes nationaux.
Il semble en revanche douteux que de tels dispositions contractuelles puissent prévaloir sur des normes de droit international. L’on pourrait même considérer que de telles clauses attesteraient au contraire de la connaissance d’un risque de contribuer à un génocide, et par là-même de l’avoir ignoré. Bref, tout comme pour l’idée d’un écran étatique, l’on voit mal un écran contractuel venir voiler la possibilité de poursuites pénales, si celles-ci ont lieu.
Encore peu de plaintes déposées au pénal
Pour l’heure, peu de plaintes au pénal ont été déposées contre des entreprises suspectées d’avoir fourni à Israël une aide militaire. En France, la Ligue des droits de l’homme a porté plainte contre les sociétés Eurolinks et IMI System pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Des associations ont également assigné en justice le Salon du Bourget pour « recel et complicité de crimes internationaux », dont le crime de génocide, pour avoir accueilli – même en les dissimulant – des entreprises israéliennes lors de sa dernière édition.
Depuis le début de la guerre, l’armée israélienne n’a cessé d’afficher sa domination technologique et militaire, et par là-même la complicité de l’industrie militaire au niveau international, via la fourniture d’avions, drones, munitions, formations, composants techniques et autres services qui lui ont permis d’atteindre le niveau de destruction observé dans la bande de Gaza. Que ce matériel ait été exporté à des fins civiles, que toutes les dispositions contractuelles aient été prises, que les États aient autorisé ces exportations, qu’aucun des dirigeants n’aient explicitement embrassé l’idéologie génocidaire affichée par des membres du gouvernement israélien n’y changent rien, ces entreprises ont bien contribué à la commission de ces crimes, et la documentation de ces complicités est sans précédent.
Il est grand temps pour la justice pénale de se saisir de ces preuves, et surtout de se confronter à la responsabilité de l’industrie militaire dans les crimes de masse. Juger les lords of war serait sans doute la seule option qui permettrait une réelle prévention des crimes internationaux.

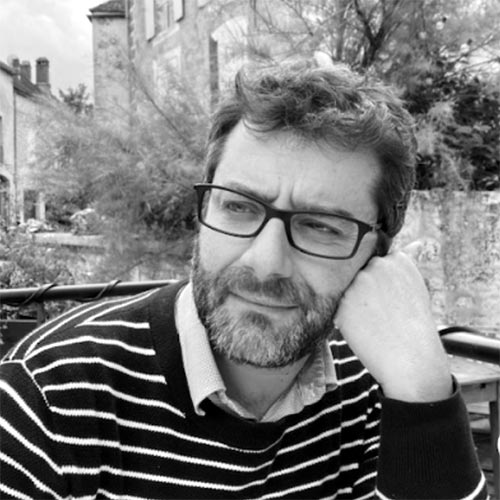
Damien Scalia est professeur de droit à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et professeur invité (en droit international pénal) à l’Université de Lausanne. Il mène depuis une quinzaine d’années des recherches sur l’expérience de justice des personnes jugées par les juridictions internationales. Il est co-directeur de la Maison des sciences humaines-ULB.

Elisa Novic est chercheuse au Centre de recherches en droit pénal de l’Université libre de Bruxelles. Elle a travaillé comme juriste pour plusieurs organisations non gouvernementales sur les questions de justice transitionnelle et sur la responsabilité des multinationales pour violations des droits humains et environnementaux. Elle est titulaire d’un doctorat en droit international de l’Institut universitaire européen.






